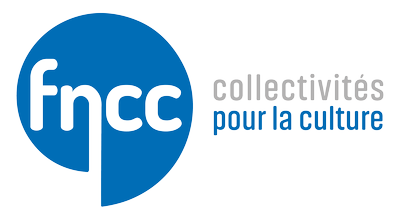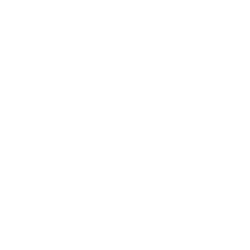L’ouvrage collectif titré Les Années Lang comporte également un sous-titre : “Une histoire des politiques culturelles 1981-1993”. Réalisé par de nombreux contributeurs placés sous la direction des chercheurs Emmanuel Wallon, Laurent Martin et Vincent Martigny, c’est un abécédaire et, à ce titre, un outil pragmatique de mise en regard de choix actuels avec des approches passées sur un très grand nombre de sujets, généraux ou sectoriels, ou encore un poste d’observation – comme un « affût » de chasseur – pour scruter et interroger l’évolution des grandes tendances qui ont marqué l’histoire des politiques culturelles de Malraux à aujourd’hui.
En consacrant un grand ouvrage collectif à un ministre en particulier, donc indirectement à la famille politique dont il est issu, on pourrait croire à un panégyrique quelque peu partisan. Ce n’est pas le cas. L’ouvrage n’est pas un éloge mais une démarche à caractère encyclopédique – avec des articles classés par ordre alphabétique, d’Antiaméricanisme à Libéralisme culturel pour la partie “Débats et combats”, d’Abirached, Robert à Tasca, Catherine pour le chapitre “Acteurs”, d’Administration à Villes pour celle consacrée aux “Institutions et pouvoirs” – prenant pour focal une période médiane, à mi-chemin entre la création du ministère de la Culture (1959) et aujourd’hui. Soit une décennie charnière entre l’époque fondatrice de la démocratisation culturelle et une actualité déployant bon an mal an le principe de la démocratie culturelle. Et “il se trouve” que la personnalité qui a tracé cette ligne de partage des eaux a été un ministre en fonction pendant les deux septennats de Mitterrand, l’un avec un gouvernement socialiste, l’autre de cohabitation.
Critique, cet ouvrage se doit immanquablement de l’être, car il s’agit de rendre compte d’une époque, de ses dynamiques sociales et de ses tensions politiques plutôt que de la pensée d’un homme ou de l’action d’un ministères (introduction).
Chaque article propose ainsi au lecteur de se placer à un point d’observation surplombant deux versants différents mais contigus des politiques culturelles, celui de la culture des “grandes œuvres” et celui de la reconnaissance de pratiques et d’esthétiques jusqu’alors perçues comme mineures ou marginales, celui de la promotion du régime classique de la production artistique et celui des industries culturelles, celui de l’œuvre et celui de la fête, ceux de l’action artistique et de la régulation culturelle, de la culture élitiste et de la culture populaire, etc. Donc un point panoramique susceptible de nourrir de connaissances et de perspectives l’acteur ou le penseur des politiques culturelles de demain mais aussi d’animer les débats, voire d’alimenter les conflits, à venir. Par exemple.
“Exception culturelle”. La notice de Vincent Martigny fait d’abord justice à l’idée commune que la notion d’exception culturelle serait fondamentalement de gauche. Une impression s’inscrivant de fait dans l’idée qu’elle relèverait tout naturellement d’une sensibilité idéologique voyant dans le marché l’ennemi de la culture, dans l’économie l’antithèse de la créativité, dans les règles de la concurrence “libre et non faussée” le Cheval de Troie de la contrainte marchande dans la décision politique. Or, la première mention explicite de l’exception culturelle, datée de 1993, apparaît dans l’argumentaire français déployé dans le cadre de traités et négociations européens par Jacques Toubon, successeur de Jack Lang au ministère de la Culture et d’Alain Carignon, ministre de la Communication dans le Gouvernement de cohabitation Balladur/Mitterrand.
Il s’agissait alors de défendre le soutien public à la culture – en l’occurrence du cinéma – lors des tractations commerciales de l’Uruguay Round entre l’Union européenne et les Etats-Unis et de faire face à la volonté américaine d’inclure le cinéma, sans différentiation avec l’ensemble des autres produits marchands, dans l’unique logique de libre échange du négoce international. D’où le recours au principe de l’exception culturelle, qui « vise à protéger les cultures européennes des “forces du marché” et du rouleau compresseur américain en généralisant un système d’aides publiques déjà mis en œuvre en France pour réguler le secteur culturel ». Jacques Toubon ira jusqu’à menacer de véto français les négociations si les produits et services culturels n’en étaient pas exclus. Ce en quoi il rejoindra très directement le célèbre combat du communiste Jack Ralite contre l’introduction des biens culturels dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). L’exception culturelle ne semble ainsi pas relever d’une source précisément socialiste…
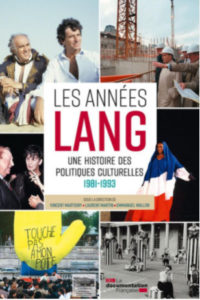 Pourquoi alors l’inclure dans un ouvrage consacré à Jacques Lang ? « L’exception culturelle prolonge une lutte politique de plus d’une décennie menée par Jack Lang et les différents gouvernements socialistes pour voir reconnue la possibilité pour les Etats de maintenir des politiques de soutien et de protection de leurs cultures nationales contre la libéralisation du commerce international. »
Pourquoi alors l’inclure dans un ouvrage consacré à Jacques Lang ? « L’exception culturelle prolonge une lutte politique de plus d’une décennie menée par Jack Lang et les différents gouvernements socialistes pour voir reconnue la possibilité pour les Etats de maintenir des politiques de soutien et de protection de leurs cultures nationales contre la libéralisation du commerce international. »
L’idée d’exception culturelle constitue en effet une extension de l’initiative sans doute la plus légitimement célébrée de Jack Lang, la loi sur le prix unique du livre – un principe décliné par la suite, à l’échelle nationale, par les lois “Sueur” et aujourd’hui par une proposition de loi de la sénatrice Laure Darcos, l’une et l’autre autorisant respectivement le financement public des établissements commerciaux que sont les salles de cinéma et les librairies. L’exception culturelle généralise le principe selon lequel « le livre n’est pas un produit comme les autres » à l’échelle de la culture en son ensemble, selon la formule inscrite dans la Déclaration sur la diversité culturelle (2005) qu’a ensuite ardemment défendu Jacques Toubon : « Les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. »
Puis, plus tard, l’exception culturelle servira d’argument nationaliste, combattu par la gauche, contre la reconnaissance des cultures minoritaires et infranationales. Vincent Martigny note ainsi ce paradoxe constitutif du récit national français porté par la gauche, « celui d’un pays promoteur de la diversité culturelle à l’extérieur mais défendant une forte homogénéité culturelle interne ». On en est là…
“Le Palace”. La journaliste Marie Ottavie titre sa notice sur la reconnaissance de la fête en tant que phénomène culturel légitime par le nom d’un célèbre cinéma parisien, puis boîte de nuit, « temple du divertissement, lieu de tous les mélanges et de mille les excès joyeux ». Avec cette explication : « La philosophie de cette immense discothèque d’un genre inédit correspond en tout point à ce qu’ambitionne d’établir le nouveau pouvoir socialiste après 1981 : un brassage ethnoculturel et un melting-pot de personnalités issues de différentes classes sociales. » Qui aurait qualifié de culture les soirées dansantes et alcoolisées des boîtes de nuit avant Jack Lang ? Mais aujourd’hui, bon nombre d’élu.e.s ne les prennent-ils pas en compte comme une part incontournable de la culture, au même titre que les bals populaires ou les carnavals ?
Il s’agit d’un tournant majeur pour les politiques culturelles. Ce sera la promotion de la BD, du street art, des musiques actuelles et aujourd’hui des séries télévisées, des jeux vidéo… Mais c’est aussi une philosophie : une autre manière d’être au monde. Jack Lang parlera « d’un lieu mythique, de bonheur, à nul autre pareil : c’était un endroit unique, où on se sentait heureux et libre. » Une sensation que, politiquement, il importe donc également de démocratiser…
« La discothèque reflète l’ouverture d’esprit qui traverse la société française dans les années 80. Elle participe aussi à la démocratisation de la fête », car à la différence des lieux traditionnels de la nuit, encadrés et coûteux, Le Palace était ouvert à tous, accueillant, avec un prix d’entrée très modéré. Finalement, un symbole dans lequel le ministre a vu « le moyen de cimenter cultures populaire et élitiste, que ses opposants aimeraient conserver aux antipodes ».
L’auteure note également que, de manière plus tacticienne, le ministre socialiste, en plus de vouloir « légitimer la fête en tant que forme culturelle », a eu conscience de l’importance de la nuit et du divertissement pour le rayonnement international ainsi que pour l’essor des industries culturelles, notamment musicales (en d’autres temps on aurait pu y croiser Joséphine Baker, maintenant panthéonisée, a posteriori grâce à Jack Lang). A parcourir ce chemin de crête entre passé et avenir que constitue cet abécédaire, on voit notamment la continuité créatrice entre “grande musique” et musiques actuelles, entre ballet et hip-hop, entre fête et musique, ce que symbolisera la Fête de la musique, initiative emblématique des années Lang qui consacre l’absence de solution de continuité entre les musiciens professionnels et en amateur.
La fête musicale, c’est également une manière de retisser le lien avec la jeunesse – ce à quoi contribuera aussi par la suite, de manière plus cadrée, les fameuses classes “à PAC” de Catherine Tasca et, aujourd’hui, l’éducation artistique et culturelle. En ce sens, Jack Lang a anticipé qu’il fallait adapter les politiques culturelles à la nouvelle génération, celle de l’après des babyboomers pour laquelle, jusqu’alors et depuis l’Après-guerre, étaient pensées et déployées les politiques culturelles.
“Hiérarchies et légitimités culturelles”. Emmanuel Wallon décrit une mutation proprement philosophique opérée par Jack Lang : à l’éloge de la démocratisation du “grand art” succède, sans le remplacer, un tournant vers une ouverture à la richesse de la diversité. Ce fut un basculement, de l’élitisme au populisme culturel, dans lequel les tenants de la tradition d’hier voyaient une source de tristesse – celle du relativisme – et ceux d’aujourd’hui une menace civilisationnelle : le danger communautariste.
Où se situe la valeur de la culture ? Dans l’œuvre elle-même ou dans ce qu’elle représente aux yeux de celles et ceux qui la reçoivent ? Ou encore, siège-t-elle dans l’accès ou dans la pratique ? A l’instar de la Convention de Faro sur “la valeur” du patrimoine culturel pour la société, un patrimoine ne vaut-il pas aussi, par-delà ses qualités scientifiques, historiques et esthétiques objectives, par sa charge subjective ? Par ce qu’il est impossible de quantifier, de mesurer, de classer. « L’impensé du classement, c’est sans doute la valeur », estime Emmanuel Wallon. Ce que le célèbre et éphémère décret renouvelant en 1982 les missions du ministère de la Culture traduit ainsi : « Permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’exprimer librement leur talent et de recevoir la formation artistique de leur choix », et ce quel que soit le résultat d’un telle inventivité démocratisée.
Le tournant opéré par Jack Lang consiste à ajouter à la valeur identifiée dans l’œuvre celle portée dans la pratique artistique non professionnelle ou commerciale, ou encore à prendre en compte les vertus de sociabilité dont un bien culturel peut être le support. A partir de 1981, sous le feu de critiques dénonçant une dérive du “tout se vaut”, s’opère une ouverture vers la reconnaissance de pratiques et d’esthétiques jusqu’alors sous-considérées que traduit une politique institutionnelle de création de multiples structures ayant pignon sur rue (de Valois) : Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières, Ecole nationale supérieure de la photographie à Arles, Lieux publics/Centre national de la création des arts de la rue à Marne-la-Vallée, Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, Centre national de la bande dessinée et de l’image à Angoulême…
Et l’auteur note que, dans ce mouvement de fond « d’ennoblissement des arts modestes », « les collectivités ne sont pas en reste ». Elles « multiplient les festivals dans tous les champs et sous-champs de l’expression culturelle » : le mime à Périgueux, le cinéma d’animation à Annecy, le conte à Chevilly-Larue… En quelque sorte, les pouvoirs locaux se sont reconnus dans cette révolution de la valeur culturelle parce que ces gestes politiques concernaient les gens tels qu’ils sont – les habitants – et non seulement des publics cultivés ou à cultiver.
A lire une autre chercheur, Guy Saez (La Gouvernance culturelle des villes/de la décentralisation à la métropolisation), on peut également soupçonner que ce tournant préfigurateur des droits culturels et des politiques de participation ne relève pas d’un suivisme local d’impulsions étatiques mais en émerge par une dynamique de territorialisation des politiques culturelles nationales. Car les élu.e.s locaux sont comptables devant les personnes et non devant des publics, devant les pratiques et non devant les œuvres ; ils sont garants d’une démocratie culturelle dont la démocratisation de l’accès aux “grandes œuvres” ne constitue qu’une facette. En d’autres termes, par la nature même de leur mandat de proximité, au-delà de la valeur d’une culture, les élu.e.s ne défendent-ils pas de fait la dignité de toutes les cultures ?
Soucieux d’objectivité scientifique, la notice “Hiérarchies et légitimités culturelles” ne se permet pas de trancher entre élitisme et populisme. Son auteur cite abondamment les détracteurs d’un ministère qui, « à l’égalité des gens devant la culture, substitua l’égalité des genres de culture et nomma cet éclectisme ouverture » (Michel Schneider, directeur de la Direction de la musique, du théâtre et des spectacles/DMDTS), tout en se plaçant sur le même terrain – périlleux mais inhérent à tout jugement de goût – de la “valeur” des œuvres. Ces détracteurs, interroge-t-il, « tiennent-ils pour insignifiantes les distinctions opérées par les amateurs et les spécialistes de ces disciplines ? Chacun des genres élevés à la dignité d’arts et honorés par la République sécrète en effet ses propres hiérarchies. »
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, on en est là, grâce à Jack Lang. Ou par sa faute ? « L’éloge de la démocratie culturelle est soupçonné d’occulter “l’échec” d’une démocratisation culturelle impuissante à mettre réellement en partage les œuvres majeures de l’art et de l’esprit. […] C’est pourquoi il serait intéressant d’observer si le débat de la réalisation des droits culturels inscrits dans les lois de 2015 et 2016 trace des perspectives nouvelles ou s’il reprend ces vieux refrains » de ce qu’Antoine Vitez nomma de la formule paradoxale “d’élitisme pour tous”.